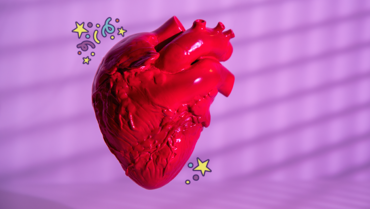Contenus Santé
Mieux connaître les maladies auto-immunes
Alors qu’il est censé nous protéger contre les agents pathogènes (virus, bactéries...), notre système immunitaire peut parfois se déréguler et s’attaquer aux constituants normaux de l’organisme1. C’est le cas dans les maladies auto-immunes.
Qu’est-ce qu’on appelle maladie auto-immune ?
Une maladie auto-immune est caractérisée par un dysfonctionnement du système immunitaire de l’organisme, entraînant l’attaque par l’organisme de ses propres tissus2.
C’est une maladie inflammatoire chronique qui peut toucher différents organes (ou système), comme la peau, les articulations, le rein, le cœur, le cerveau3…
On distingue :
les maladies auto-immunes dites « spécifiques d’organe » qui vont se définir par l’atteinte d’un seul organe.
les maladies auto-immunes dites « non spécifiques d’organe », qui vont se définir par une atteinte de différents organes3.
Maladie auto-immune : quels sont les facteurs en cause4 ?
L’origine des maladies auto-immunes reste mal connue. Une association de plusieurs facteurs environnementaux, hormonaux, génétiques, médicamenteux, infectieux et psychologiques est fort probable. La responsabilité respective de chaque facteur dans la survenue d’une maladie auto immune n’est pas connue et va dépendre du type de maladie auto immune sous-jacente. On parle de maladie d’origine multifactorielle.
Facteurs génétiques
La survenue d’une maladie auto-immune est en partie liée à une prédisposition génétique. Cette prédisposition génétique explique environ 30 % de la cause de la maladie.
Facteurs hormonaux
Il existe une relation entre les hormones sexuelles et la réponse immunitaire. L’action des hormones sur l’activité de la maladie auto-immune est variable selon les maladies.
Facteurs infectieux
- Des facteurs infectieux sont de plus en plus incriminés. Mais la relation directe entre une infection et la survenue d’une maladie auto-immune n’est pas établie.
Facteurs environnementaux
Certains facteurs d’environnement, comme les agents infectieux semblent favoriser les réactions inflammatoires, la survenue de maladie auto-immunes, voire la réponse aux traitements.
Facteurs médicamenteux
- Certains médicaments peuvent favoriser certaines maladies auto immunes, et en particulier, le lupus.
Facteurs psychologiques
Dans 20 à 30 % des cas, on constate que la maladie auto immune s’est déclenchée après un événement marquant, « stressant » tel qu’un traumatisme physique ou psychique (deuil, séparation, accouchement, intervention chirurgicale, etc.).
Le saviez-vous ?
De nombreuses maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes2.
Comment surviennent les réactions auto-immunes2 ?
Les réactions auto-immunes peuvent être déclenchées de différentes façons :
Une substance corporelle normale est altérée, par exemple, sous l’effet d’un virus, de la prise de médicaments, de la lumière solaire ou des radiations. La substance altérée peut alors être considérée comme étrangère par le système immunitaire.
Une substance étrangère qui ressemble à une substance normale de l’organisme peut y pénétrer. Le système immunitaire peut cibler par inadvertance la substance corporelle similaire en même temps que la substance étrangère.
Les cellules qui contrôlent la production d’anticorps, par exemple, les lymphocytes B (un type de globules blancs), peuvent mal fonctionner et produire des anticorps anormaux qui attaquent certaines cellules de l’organisme.
Les lymphocytes T, un autre type de globules blancs impliqués dans la réponse immunitaire, peuvent également mal fonctionner et endommager les cellules de l’organisme.
Une substance normalement confinée dans une région spécifique de l’organisme (et donc cachée pour le système immunitaire) est libérée dans la circulation.
Quels sont les symptômes des maladies auto-immunes2 ?
Les symptômes varient en fonction de la maladie et de la partie de l’organisme affectée.
Certaines maladies auto-immunes affectent certains types de tissus de l’organisme, par exemple, les vaisseaux sanguins, les cartilages ou la peau. D’autres maladies auto-immunes touchent un organe particulier. Pratiquement n’importe quel organe peut être affecté, y compris les reins, les poumons, le cœur ou le cerveau.
L’inflammation et les lésions tissulaires qui en résultent peuvent provoquer des douleurs, des déformations articulaires, une faiblesse, un ictère, des démangeaisons, une difficulté respiratoire, une accumulation de liquide (œdème), un délire, voire la mort.
Comment diagnostique-t-on les maladies auto-immunes1 ?
Beaucoup de maladies auto-immunes se manifestent par des phases de poussées, durant lesquelles les symptômes s’intensifient, entrecoupées par des périodes de rémission.
Mais d’autres sont associées à des symptômes constants, qui peuvent évoluer avec le temps.
Leur diagnostic repose sur des éléments cliniques et biologiques, parfois complétés par des données histologiques (analyse de biopsies), génétiques et d’imagerie.
Maladies auto-immunes : quelles prises en charge ?
Dans les maladies auto-immunes, la prise en charge est souvent pluridisciplinaire, avec différents spécialistes selon les organes atteints, et d’autres professionnels de santé : médecin traitant, pharmacien, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, infirmiers, psychologues… La prise en charge des maladies auto-immunes comprend les traitements médicamenteux et non médicamenteux5.
Les traitements médicamenteux
Il n’existe pas de traitement qui permette de guérir d’une maladie auto-immune. Les traitements actuellement disponibles vont uniquement permettre de corriger les désordres engendrés par les processus immunitaires. Ils permettent le plus souvent de rétablir un fonctionnement le plus normal possible et d’obtenir la rémission des symptômes.
Il faut toutefois noter que l’on manque de traitements efficaces dans plusieurs maladies auto-immunes systémiques, comme le syndrome de Gougerot Sjögren ou la sclérodermie systémique1.
Des traitements symptomatiques sont prescrits pour soulager les manifestations de la maladie : antalgiques contre la douleur, anti-inflammatoires contre la gêne fonctionnelle articulaire, médicaments substitutifs permettant de normaliser les troubles endocriniens.
Des médicaments qui permettent de contrôler ou d’inhiber l’auto-immunité offrent aussi un moyen de limiter les symptômes et la progression des lésions tissulaires. Mais la maladie restera chronique et il est rare que le traitement puisse être arrêté de façon prolongée1.
La place des traitements non médicamenteux
En dehors des poussées inflammatoires une activité physique régulière est importante pour éviter l’affaiblissement des muscles, l’enraidissement des articulations, réduire un handicap (cutanée, articulaire, pulmonaire…), lutter contre la fatigue et garder une bonne forme physique. La place de la kinésithérapie et des ergothérapeutes dans la prise en charge des maladies auto-immunes est importante5.
Un soutien psychologique est parfois nécessaire pour apprendre à vivre avec la maladie et gérer un stress qui peut favoriser les poussées des maladies auto-immunes5.
Quelques maladies auto-immunes
Il existe de nombreuses maladies auto-immunes.
Anémie hémolytique auto-immune : Une anémie (diminution du nombre de globules rouges) se développe, induisant fatigue, faiblesse et sensation de vertige. La rate peut augmenter de volume. Elle peut être grave, voire mortelle.2
Anémie pernicieuse : Une lésion des cellules de la muqueuse gastrique rend l’absorption de la vitamine B12 difficile. Il en résulte une anémie, souvent à l’origine de fatigue, de faiblesse et de vertiges. Les nerfs peuvent être lésés, ce qui induit une faiblesse et une perte de sensation. Sans traitement, la moelle épinière peut être lésée, contribuant finalement à une perte de sensation, à une faiblesse et à une incontinence.2
Diabète de type 1 : Les symptômes peuvent comprendre une soif, une miction et un appétit excessifs ainsi que diverses complications à long terme. Un traitement à vie par insuline est nécessaire, même si la destruction des cellules pancréatiques s’arrête car il n’en reste pas assez pour produire suffisamment d’insuline.2
Lupus érythémateux systémique (lupus) : Les articulations, bien qu’enflammées, ne se déforment pas. Des symptômes d’anémie peuvent se développer, tels que de la fatigue, une faiblesse ou une sensation de vertige, de même que ceux associés aux pathologies rénales, pulmonaires ou cardiaques, tels qu’une fatigue, un essoufflement, des démangeaisons ou des douleurs thoraciques. Une éruption cutanée peut se manifester. La perte de cheveux est fréquente.2
Maladie de Graves-Basedow : La thyroïde est stimulée et grossit, ce qui entraîne des taux élevés d’hormones thyroïdiennes (hyperthyroïdie). Les symptômes peuvent comprendre une accélération du rythme cardiaque, une intolérance à la chaleur, des tremblements, une perte de poids ainsi que de la nervosité.2
Myasthénie grave : Les muscles, notamment ceux des yeux, s’affaiblissent et se fatiguent facilement, mais la faiblesse est d’intensité variable. Le modèle d’évolution varie énormément.2
Pemphigoïde bulleuse : De grosses cloques, entourées de zones rouges et gonflées se forment sur la peau. Les démangeaisons sont fréquentes. Le trouble affecte principalement les personnes âgées et peut être mortel, surtout chez les personnes âgées qui sont atteintes d’autres troubles.2
Pemphigus vulgaire : De larges cloques se forment sur la peau et les muqueuses (la muqueuse buccale par exemple). Ce trouble peut être mortel s’il n’est pas traité.2
Polyarthrite rhumatoïde : De nombreux symptômes sont possibles. Il peut s’agir de fièvre, de fatigue, de douleur articulaire, de raideur articulaire, de déformation articulaire, d’essoufflement, de perte de sensation, de faiblesse, d’éruptions cutanées, de douleur thoracique ou de gonflements des articulations et des tendons.2
Sclérose en plaques : L’enveloppe des cellules nerveuses affectées est endommagée. Par conséquent, les cellules ne parviennent pas à conduire normalement les signaux nerveux. Les symptômes peuvent comprendre une faiblesse, des sensations anormales, des vertiges, des troubles de la vision, des spasmes musculaires ou une incontinence. Les symptômes varient avec le temps et peuvent aller et venir.2
Sclérose systémique : c’est une maladie auto-immune du tissu conjonctif chronique rare, caractérisée par des anomalies dégénératives et une fibrose de la peau, des articulations et des organes internes, et par des anomalies vasculaires.6
Syndrome de Goodpasture : Des symptômes tels qu’un essoufflement, une toux sanglante, de la fatigue ou un gonflement peuvent se développer.2
Syndrome de Sjögren : c’est une maladie auto-immune du tissu conjonctif fréquente. Il se caractérise par une sécheresse excessive des yeux, de la bouche et des autres muqueuses.7
Thyroïdite d’Hashimoto : La thyroïde est enflammée et lésée, ce qui induit de faibles taux d’hormones thyroïdiennes (hypothyroïdie). Les symptômes peuvent comprendre une prise de poids, une peau épaisse, une intolérance au froid ou une somnolence.2
Vascularite : La vascularite peut affecter les vaisseaux sanguins d’une partie de l’organisme (telle que les nerfs, la tête, la peau, les reins, les poumons ou les intestins) ou de plusieurs parties. Il en existe plusieurs types. Les symptômes (par exemple, éruptions cutanées, douleur abdominale, perte de poids, difficulté à respirer, toux, douleur thoracique, céphalées, perte de la vision ainsi que symptômes de lésion nerveuse ou d’insuffisance rénale) dépendent de la partie du corps qui est affectée.2
L'essentiel à retenir
Qu'est-ce qu'on appelle maladie auto-immune ?2
Une maladie auto-immune est caractérisée par un dysfonctionnement du système immunitaire de l’organisme, entraînant l’attaque par l’organisme de ses propres tissus.
Maladie auto-immune : quels sont les facteurs en cause ?4
L’origine des maladies auto-immunes reste mal connue. Une association de plusieurs facteurs environnementaux, hormonaux, génétiques, médicamenteux, infectieux et psychologiques est fort probable. On parle de maladie d’origine multifactorielle.
Quels sont les symptômes des maladies auto-immunes ?2
Les symptômes varient en fonction de la maladie et de la partie de l’organisme affectée. Certaines maladies auto-immunes affectent certains types de tissus de l’organisme, par exemple, les vaisseaux sanguins, les cartilages ou la peau. D’autres maladies auto-immunes touchent un organe particulier.
Comment diagnostique-t-on les maladies auto-immunes ?1
Leur diagnostic repose sur des éléments cliniques et biologiques, parfois complétés par des données histologiques (analyse de biopsies), génétiques et d’imagerie.
Comment sont prises en charge les maladies auto-immune ?5
Dans les maladies auto-immunes, la prise en charge est souvent pluridisciplinaire, avec différents spécialistes selon les organes atteints, et d’autres professionnels de santé : médecin traitant, pharmacien, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, infirmiers, psychologues… La prise en charge des maladies auto-immunes comprend les traitements médicamenteux et non médicamenteux5.
Sources
1 - Inserm - Maladies auto-immunes - La rupture de la tolérance au soi – 17-11-2023 - Lien de la page – Consulté le 09-10-2024 | 2 - Le Manuel MSD - Maladies auto-immunes – 10-2022 - Lien de la page – Consulté le 31-10-2024 | 3 - Société Française de Rhumatologie - Une maladie auto-immune, c‘est quoi ? 24/05/2024 - Lien de la page – Consulté le 31-10-2024 | 4 - Société Française de Rhumatologie - Quelles sont les causes des maladies auto immunes -14-03-2019- Lien de la page – Consulté le 31-10-2024 | 5 - Société Française de Rhumatologie - Comment traiter les maladies auto-immunes non spécifiques d’organe ? 14-03-2019- Lien de la page – Consulté le 31-10-2024 | 6 - Le Manuel MSD - Sclérose systémique – 10-2022 - Lien de la page – Consulté le 18-11-2024 | 7 - Le Manuel MSD - Syndrome de Sjögren - 10-2022 - Lien de la page – Consulté le 18-11-2024
PO-02757-11/24